
Gaza : l’Union européenne hésite à jouer ses cartes pour sanctionner Israël pour violations des droits humains
Les chefs de la diplomatie des pays de l’Union européenne se réunissent ce mardi pour essayer de trouver d’éventuelles mesures contre Israël accusée d’avoir violé ses obligations en matière de droits humains à Gaza. Mais les diplomates doutent qu’ils réussiront à s’entendre aujourd’hui sur des mesures à adopter.
Les diplomates se réunissent ce mardi 15 juillet pour évoquer la question des mesures contre Israël. L’Union européenne (UE) a officiellement reconnu, en juin dernier, que les actions d’Israël à Gaza et en Cisjordanie constituent une violation de la clause relative aux droits humains de l’Accord d’association UE-Israël, entré en vigueur le 1er juin 2000. Il réprésente 46,8 milliards d’euros d’échanges commerciaux entre l’UE et Israël. Les rapports de la Commission européenne et du Service européen pour l’action extérieure documentent des actes graves : blocus de l’aide humanitaire, frappes militaires contre des hôpitaux, déplacements forcés de populations palestiniennes, détentions arbitraires et traitements dégradants de prisonniers. Amnesty International et Human Rights Watch appellent l’UE à suspendre cet accord et à imposer des sanctions immédiates.
En juin, la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a établi une liste de possibles sanctions à mettre en place : une suspension totale ou partielle de l’Accord d’association UE-Israël, une suspension des préférences commerciales ou de l’accès à certains programmes européens (comme Horizon Europe, le programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation), un blocage des importations issues des colonies, une suspension des voyages sans visas pour les citoyens israéliens, un embargo sur les armes, des sanctions ciblées contre des responsables israéliens (notamment ceux impliqués dans les colonies ou des violations graves), ou encore le gel de la coopération scientifique ou aérienne.
Les sources de l’hésitation
Cependant, les diplomates de l’Union européenne ne semblent pas trouver une option unanimement appréciable. Malgré des constatations et la pression de plusieurs États membres (Espagne, Irlande, Slovénie, France, Suède), l’UE reste divisée et réticente à toute mesure concrète contre Israël.
Pour pouvoir mettre en place n’importe quelle mesure, il y a une nécessité d’unanimité. L’unanimité offre donc un droit de veto à chacune des parties prenantes d’un vote puisqu’il suffit d’une seule voix contre pour invalider la décision. La suspension de l’accord ou un embargo sur les armes, nécessitent cette unanimité, c’est-à-dire l’accord des 27 États membres. Néanmoins, un noyau d’États (Hongrie, Tchéquie, Allemagne, Italie, Autriche, Grèce, Chypre, Croatie, Lituanie, Bulgarie, Roumanie) s’y opposent systématiquement. L’équilibre politique interne n’est pas non plus au rendez-vous pour permettre de prendre des décisions communes. L’UE craint donc d’accroître ses divisions internes ou de nuire à son image d’acteur neutre au Moyen-Orient en appliquant de telles mesures contre Israël. Les intérêts économiques sont aussi un frein. Israël est un partenaire majeur pour certains secteurs comme la technologie, la sécurité, ou même le commerce. C’est notamment Niamh Ni Bhriain, coordinateur du programme de guerre et paix au Transnational Institute, qui a souligné, le 10 juillet dernier, que les intérêts économiques continuent de l’emporter sur les droits de l’homme au sein de l’UE.
Une inaction européenne dénoncée par un grand nombre d’acteurs : ONG, anciens diplomates, certains gouvernements membres et une partie de l’opinion publique. Plusieurs observateurs parlent d’une « faillite morale » de l’UE, paralysée par ses intérêts et ses divisions internes, alors même qu’elle s’est montrée bien plus réactive pour d’autres dossiers comme l’Ukraine.
Share this content:


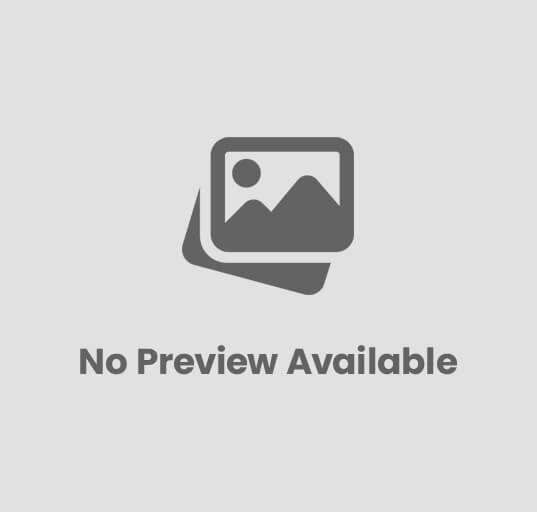



Laisser un commentaire